ANTHROPOCÈNE ET APOCALYPSE
1. Terre des Hommes
2. Saint Jean et sa juste vision
3. Violence de l'homme-dieu
4. Vive l'inadaptation, facteur d'évolution!
1. Terre des Hommes
En 1939,
Antoine de Saint-Exupéry offre au public Terre
des hommes, un recueil d’essais autobiographiques publié chez Gallimard et qui
lui vaudra le Grand Prix du roman de l’Académie française. Aussitôt traduit en
anglais sous le titre Wind, Sand and
Stars, l’ouvrage est couronné par le National Book Award. Terre des hommes sera aussi en 1967 le
thème de l’Exposition universelle de Montréal – Man and his World, en anglais. Si mon souvenir est bon (j’étais
enfant à l’époque!), des féministes avaient jugé inconvenant ce titre, car
c’est aussi la Terre des femmes, et une grande écrivaine, Marguerite Yourcenar
si je ne m’abuse, avait déclaré que cette Terre n’est pas que celle des
humains, mais aussi celle de la Nature et des autres êtres vivants. Les
antispécistes seraient bien d’accord. Dans les années 1960 encore se tenait le
Concile Vatican II de l’Église catholique – un concile œcuménique en fait. Et
la constitution pastorale Gaudium et spes
du Concile appelle ce devoir : «Édifier un monde qui soit vraiment plus
humain pour tous et en tout lieu». Cet idéal d’un «monde plus humain» est
d’ailleurs récurrent dans le discours Chrétien.
 |
| Logo d'Expo 67 par Julien Hébert |
«Plus
humain» et «en tout lieu», nous y voici enfin, mais peut-être pas de la manière
attendue. En août dernier, lors du Congrès géologique international qui a eu
lieu en Afrique du Sud, «des scientifiques ont voté à trente voix contre trois
(dont deux abstentions) que le passage à l'anthropocène devait être déclaré». L’anthropocène,
l’âge de l’Homme : et là, il s’agit rien de moins que d’une nouvelle ère
géologique, qui succède ainsi à l’holocène qui avait duré quelques 10 000
ans.
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/06/007-ere-terre-anthropocene-homme-planete-geologie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/06/007-ere-terre-anthropocene-homme-planete-geologie.shtml
L’anthropocène
aurait donc débuté autour de 1950, moment à partir duquel l’action de
l’humanité est devenue tellement forte sur Terre, tellement profonde et
globale, que les transformations qu’elle entraîne s’inscriront de manière
définitive dans les couches géologiques de la planète, sa mémoire matérielle.
Sur tous les plans, les modifications apportées par l’Homme se font
sentir : dispersion d’éléments radioactifs dans l’atmosphère,
bouleversements climatiques, acidification des océans, vague d’extinction
d’espèces vivantes la plus massive depuis l’ère des dinosaures,
artificialisation extrême des milieux naturels, etc. L’Homme prend le contrôle
et le fait savoir! Désormais, tout ce qui est sur Terre l’est pour lui et pour
lui seul, d’autant que ses «besoins», comme sa population, ont été multipliés de façon exponentielle,
et ne se limitent plus, loin de là, à se nourrir, se vêtir, se loger… La pression
nataliste ne figure pas dans le Nouveau Testament, mais elle a été exercée en
plusieurs pays de tradition catholique, comme au Québec où avant les années
1960 il était très mal vu par l’Église locale qu’une femme n’ait pas un enfant
tous les ans ou aux deux ans : avoir une très grande famille était
considéré presque comme une obligation du mariage – le Pape François a tout de
même ironisé sur cela en déclarant qu’être Catholique ne signifie pas être des
lapins (certaines personnes n’ont pas dû trouver cette remarque trop drôle)…
Cette pression a hâté l’avènement de l’anthropocène, surtout lorsqu’elle s’est
doublée de la chute de la mortalité infantile grâce aux progrès de la médecine.
2. Saint Jean
et sa juste Vision
 |
| Saint Jean à Patmos, par Jérôme Bosch |
Dans la
Bible, il est souvent question de signes dans le ciel qui annoncent des temps
nouveaux. Par exemple, ce passage de l’Évangile selon saint Luc : «Il y
aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles», qui ajoute
que la Nature sur Terre donnera elle aussi des signes : «Sur la terre, les
nations seront dans l’angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la
mer et des vagues» (Chapitre 21, versets 25 et 26). Des annonceux de fin du monde
en profitent mais, à chaque fois, se trouvent des gens pour dire que mais non… Et
pourtant, oh que oui, il y en a eu des signes, dans le ciel et sur Terre, ces
dernières décennies! Mais comme la pollution lumineuse (autre symptôme de
l’anthropocène) nous cache la voûte céleste, peut-être ne les voyons-nous plus.
Oui, le ciel
a été ébranlé au 20e siècle, les astres et les étoiles! Du moins
dans notre perception, ce qui revient au même pour les Mortels que nous sommes.
Cet ébranlement a fait la première page du magazine Time en Janvier 1968 : des photos de notre Terre prise par
William Anders, un des trois astronautes de la mission Apollo 8 qui a eu lieu
en décembre 1967.
 |
| La Terre depuis Apollo 8. |
Saint Jean a
écrit son Apocalypse, le dernier
livre du Nouveau Testament de la Bible, quelques temps après le passage de
Jésus. Sous l’inspiration d’Anges. Le titre signifie Révélation. Jean écrit ainsi : «L’un des sept anges (…) vint
me dire : «Viens et je te montrerai la mariée, l’épouse de l’Agneau». Jean
poursuit : «L’Esprit se saisit de moi et l’ange me transporta au sommet
d’une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui
descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La
ville brillait d’un éclat semblable à celui d’une pierre précieuse (…)». Je
crois que l’Ange lui a en fait montré la Terre. Jean écrit : «Alors je vis
un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et il n’y avait plus de mer (…). Alors celui qui siège sur le
trône déclara : «Maintenant, je fais toutes choses nouvelles». Je trouve
triste que tant d’exégètes cherchent à déposséder ce livre visionnaire de son
côté visionnaire justement, pour l’écrapoutir et le banaliser comme plutôt un
«récit symbolique qui parle de la situation de l’époque de Jean en des termes
codés», ou «un message d’espoir pour les Chrétiens qui subissaient alors des
persécutions» - des lectures matérialistes, déspiritualisées et étriquées. Non,
l’Apocalypse n’est pas ça, du moins
pas que ça, pas ça d’abord. Ce livre rapporte des visions dont certaines se
sont éclairées récemment, alors que d’autres demeurent énigmatiques avec des
clés se situant encore dans l’avenir. C’est bel et bien ce que soutenait déjà
le prophète Habacuc dans l’Ancien Testament au sujet de la réalité des visions :
«[Le Seigneur me dit] : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement,
pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps
fixé; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas».
 |
| Tenture de l'Apocalypse, Angers XIVe siècle |
Une vision
qui tendra vers son accomplissement au temps fixé. Je ne crois pas que nous
vivions la grande Apocalypse de saint Jean, mais nous vivons du moins une
véritable petite Apocalypse. Car, la Grande reste à venir : (Saint Jean)
«Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et
ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux (…). Il essuiera toute
larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni lamentation,
ni douleur. Les choses anciennes auront disparu». À venir toujours : «Je
ne vis pas de temple dans cette ville (céleste), car elle avait pour temple le
Seigneur lui-même, le Dieu tout-puissant et l’Agneau. La ville n’a besoin ni du
soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et
l’Agneau est sa lampe». À l'âge de l'anthropocène, il nous est acquis de parler de la Terre comme étant devenue un «village global». Mais ce l'était beaucoup moins il y a 2000 ans lorsque saint Paul a osé écrire ceci: «Le mystère du Christ, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse». Visionnaire.
3. Violence de
l’Homme-dieu
Mais aux
yeux des cyniques, notre Petite Apocalypse pourrait plutôt sembler être celle
d’un homme-dieu qui s’est imposé par la violence. Y aurait-il deux Dieux :
celui qui est «Créateur du Ciel et de la Terre, de l’Univers visible et
invisible» (Credo de Nicée-Constantinople), et celui qui n’est que la
projection surdimensionnée des ambitions de l’être humain et de son inconscient
collectif? Au 2e siècle, saint Irénée, évêque de Lyon, écrivait
ces mots époustouflants : «Dieu s’est homme pour que l’homme devienne
Dieu». Nous avons franchi une étape, symbolisée par la reconnaissance
scientifique de l’anthropocène, celle de la petite Apocalypse, l’apocalypse de
l’Homme. Par sa tension dans l’histoire, son souffle d’avenir, le Christianisme
a joué un rôle majeur dans l’avènement de cette révélation, lui qui loue
Dieu-parmi-nous et qui a été assuré de la présence de Dieu au milieu de
l’humanité. Mais tout n’est pas accompli.
Pour
certains adorateurs du cyborg, l’avenir sera l’affaire du couple humain-machine :
la science «perfectionnera» l’homme. Pour d’autres, «Et si, contrairement à
l’idée reçue, c’était la Nature qui achevait d’humaniser l’Homme?» (Abdourahman
Waberi, Le Monde). Peu importe, l’être humain n’est pas du tout un animal comme
les autres, loin de là. Car il apporte la crise sur Terre. Voici ce que le
regretté écrivain «punk-cybernético-catholique» Maurice G. Dantec (1959-2016)
écrivait assez justement : «En appliquant grossièrement la «sélection
naturelle» ou l’égoïsme génétique au monde humain, (des scientifiques) perdent
de vue que l’homme est précisément ce moment où la nature décide de se
retourner contre elle-même. L’homme est une crise,
un appareil critique de la nature, il n’a pas pour finalité l’aboutissement du
processus naturel et/ou historique, pas plus qu’il n’est un simple assemblage
hasardeux né d’une main invisible jouant aux dés, l’homme semble être là pour
détruire l’ordre naturel, pour disséquer, dissoudre, corrompre, contaminer le
monde phénoménal de ses propres expériences» (Manuel de survie en territoire zéro. 1 – Le théâtre des opérations.
Journal métaphysique et polémique, 1999).
Une
crise voulue par Dieu. Qui nous guide tout de même, ne serait-ce qu’à travers
des textes comme l’encyclique Loué
sois-tu du Pape François :
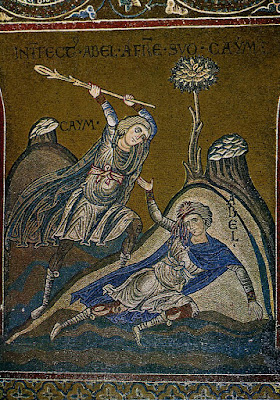 |
| Mosaïque Cathédrale de Monreale |
La
Bible s’ouvre par le livre de la Genèse. Et les choses commencent plutôt mal!
L’Homme a mal employé sa liberté, ce qui l’a coupé d’un lien direct avec Dieu.
Et déjà Caïn osera assassiner son propre frère, Abel. L’histoire humaine est
d’une violence inouïe, nul besoin de chercher fort. Ces petits et grands
criminels ont tous été d’adorables poupons.
Une étude récente
parue (septembre 2016) dans la revue Nature
a chiffré la violence humaine, celle que des humains infligent à d’autres
humains (violence intraspécifique), et l’a comparée avec celle d’autres
espèces. José María Gómez et ses collègues des universités de Grenade et Roi Juan
Carlos de Madrid, en Espagne «ont ainsi observé que la violence meurtrière
était rarissime, voire inexistante chez les chauves-souris, les baleines et les
lagomorphes [rongeurs], alors qu’elle s’avérait particulièrement fréquente chez
les primates». Depuis l’apparition de l’Homme, sa violence intraspécifique est
responsable de 2 % des décès totaux, soit plus de six fois plus que chez
les premiers mammifères, et un taux plus élevé que le taux moyen chez les
mammifères actuels. Mais en certaines époques, assez récentes encore, ce taux a
grimpé à des records de 15 et même 30%! Les chercheurs concluent que l’Homme démontre une
(euphémisme) «certaine propension à la violence meurtrière envers ses
congénères». Mais bonne nouvelle, «les sociétés modernes, parce qu’elles possèdent des
systèmes légaux, des services de police, des prisons et qu’elles rejettent
fortement la violence, présentent des taux d’homicides ne comptant que pour
0,01 % des décès totaux». Bon, cela ne dit rien de la violence que font
quelquefois régner ces sociétés modernes sur d’autres populations humaines,
comme la violence des compagnies spoliant les ressources naturelles dans certains
pays – voir le cas du Congo…
La Petite Apocalypse prend ainsi des allures de caricature sinistre de la Cité de Dieu. N'y a-t-il pas aujourd'hui un nombre record de réfugiés à cause de nos guerres? Saint Augustin dirait que le péché originel nous ayant banni du Paradis terrestre, le Christ nous guide vers un monde qui serait un moindre mal. Encore faudrait-il oser le suivre...
4. Vive
l’inadaptation, facteur d'évolution!
Mais il est
un autre point montrant que l’Homme est une crise, un «appareil critique de la
nature». Dans la nature, la survie va aux plus forts. Elle est impitoyable pour
les individus faibles, mal adaptés ou malades. La compassion y est rare, ce qui
fait d’autant plus ressortir la beauté de la Grive de Bicknell qui n’hésite pas
à nourrir et soigner des oisillons abandonnés même d’autres espèces… L’Homme,
lui, est capable de compassion (capable n’impliquant pas de soi qu’il se montre
toujours compatissant). En plusieurs collectivités et cultures, les enfants
faibles, malades ou inadaptés ne seront pas mis à mort ou laissés sans soins.
Souvent même, leur sort émeut et suscite le dévouement. Il peut de plus en
aller de même face aux adultes dans les mêmes situations. Cette compassion est
étrangère à la nature. Or, que l’on parle de compassion (comme dans le
Bouddhisme) ou de Bienveillance (comme dans le Christianisme), la spiritualité
a joué un rôle incontournable dans la promotion d’une telle attitude «alternaturelle»,
un rôle irremplaçable même. Seuls des régimes politiques antireligieux et
antispirituels (avoués ou non) ont mis en place des lois eugéniques et pratiqué
l’extermination de leurs semblables. La spiritualité, religieuse ou non à la limite,
est comme un humus, une terre nourricière. Infiniment précieuse et garante
d’évolution, la spiritualité devrait être cultivée, voire protégée. Les
croisades antireligieuses et antispirituelles d’aujourd’hui (et j’inclus ici
les déviations monstrueuses de la foi) sont des aberrations morales.
Maurice
Dantec poursuit avec raison : «L’Homme, en tant qu’entité biologique, est
complètement inadapté au monde qui l’a vu naître. Aucun bébé humain ne peut
survivre dans la nature. Jusqu’à l’âge de cinq ou six ans cela lui est
parfaitement impossible sans l’aide des autres êtres humains, et j’oserais dire
que cela ne va pas en s’arrangeant avec l’âge». Sa conclusion est superbe, et
véritablement Chrétienne, car Jésus a constamment démontré un souci envers les
pauvres, les malades, les petits, les faibles, les exclus : «Les individus
humains les plus «forts», ceux-là même qui tirent le genre humain vers le haut,
sont précisément des individus largement inadaptés, «tarés» selon le point de
vue darwinien-hégélien orthodoxe. Non seulement inadaptés à leur société et à
leurs contemporains, quelle que soit leur époque, mais inadaptés et
inadaptables au monde».
Source des illustrations: Wikipédia (Domaine public, PD-US)












